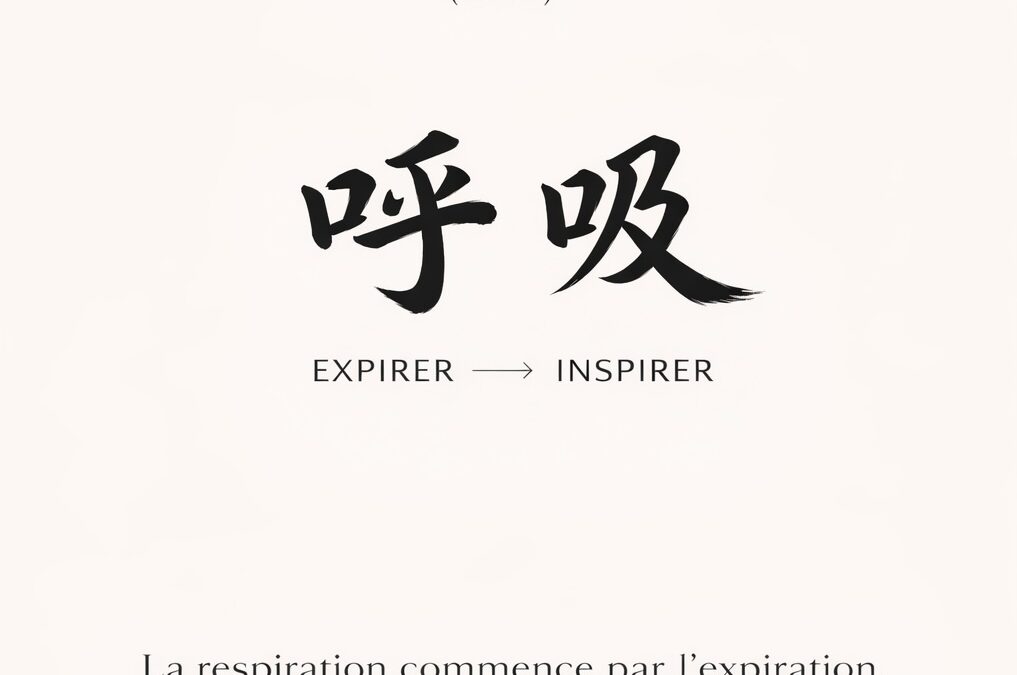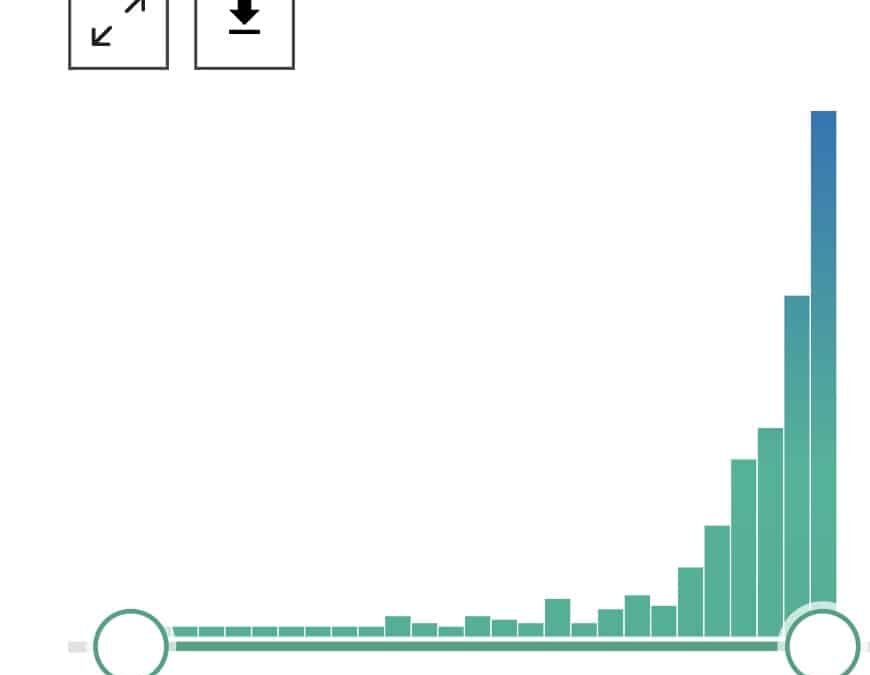La plupart d’entre nous tiennent leur souffle entre 30 et 90 secondes. Au-delà de quelques minutes sans respirer, la survie est en jeu. C’est dire l’exploit réalisé par le Croate Vitomir Maričić : 29 minutes et 3 secondes d’apnée statique, allongé à la surface d’une piscine de 3 mètres de diamètre. Un nouveau record du monde Guinness pour la « plus longue apnée volontaire avec oxygène ».
Cinq minutes de plus que le précédent record (2021, Budimir Šobat, lui aussi Croate), et environ… soixante fois la capacité d’un être humain « ordinaire ».
Comment est-ce possible ? Une plongée dans la physiologie
L’exploit de Maričić n’est pas qu’une question de volonté : il repose sur une préparation minutieuse, exploitant au maximum les ressources physiologiques du corps humain.
1. Le travail ventilatoire.
Les apnéistes entraînent leur diaphragme et leurs muscles respiratoires (intercostaux, scalènes, sternocléidomastoïdiens…) pour assouplir la cage thoracique et augmenter le volume pulmonaire. Plus de volume, c’est plus d’air, donc plus d’oxygène disponible. Cet assouplissement permet aussi de mieux tolérer les contractions involontaires qui apparaissent lorsque le réflexe de survie cherche à déclencher une inspiration : elles deviennent « un peu » plus supportables.
2. L’entraînement cardiovasculaire.
Natation, course, vélo… Ces disciplines améliorent la capacité du corps à capter, stocker, transporter et livrer l’oxygène. Un cœur entraîné est plus efficace, le débit sanguin est optimisé, et la myoglobine des muscles devient un réservoir précieux. Résultat : l’oxygène est mieux utilisé là où il est vital.
3. La tolérance au CO₂.
Contrairement à ce que l’on croit, ce n’est pas le manque d’oxygène qui nous fait paniquer, mais l’accumulation de dioxyde de carbone. Les apnéistes s’habituent progressivement à des niveaux élevés de CO₂, retardant ainsi le « point de rupture » où le diaphragme se contracte violemment pour imposer une respiration.
4. L’oxygène exogène.
Avant son record, Maričić a inhalé 100 % d’oxygène pendant dix minutes. Cette technique charge l’hémoglobine au maximum et augmente la dissolution d’oxygène dans le plasma (qui ne transporte normalement que ~2 % de l’oxygène total). Résultat : des réserves accrues qui retardent l’hypoxie, c’est-à-dire le moment où le manque d’oxygène devient critique.
5. L’économie d’énergie.
Enfin, tout se joue dans l’immobilité et la relaxation. Maričić, comme tous les apnéistes de haut niveau, abaisse volontairement son rythme cardiaque, réduit sa consommation musculaire et plonge dans un état proche de la méditation profonde. Après la barre des 20 minutes, dit-il, « tout est devenu plus facile, du moins mentalement ».
L’explorateur de l’invisible
Vitomir Maričić rejoint la lignée des explorateurs du souffle. Dans les années 2000, Herbert Nitsch descendait à 214 mètres en « No Limit » (discipline aujourd’hui interdite en compétition), affrontant une pression 22 fois supérieure à celle de la surface, avec des contraintes mécaniques et biochimiques vertigineuses.
Ces pionniers ouvrent des portes. Leur audace nourrit la recherche sur les capacités d’adaptation humaine et inspire des applications dans des domaines où la survie dépend de la gestion de l’oxygène : exploration spatiale, opérations militaires, médecine hyperbare.
Pourquoi chercher ces limites ?
On peut légitimement se demander : pourquoi partir à la recherche de ces extrêmes ?
Pour Maričić, qui a passé sa vie sous l’eau, l’apnée n’est pas seulement une discipline sportive, mais une mission viscérale. Associé à Sea Shepherd, il milite pour la sauvegarde des mers et des océans. Son message est clair : « les océans sont vides ». Montrer au monde que l’homme appartient bien à la nature qu’il détruit est une motivation profonde. Et en 29 minutes d’apnée, il y a le temps de contempler cette nature, d’en mesurer la fragilité et le silence.
Jusqu’où aller ? La question éthique
Faut-il considérer comme « juste » une performance réalisée avec une concentration artificielle d’oxygène ? Après tout, l’O₂ existe dans la nature. Mais concentré, préparé, inhalé de façon exogène, il change radicalement les règles du jeu. Où tracer la ligne entre l’exploit « humain » et l’exploit « assisté » ?
Ces débats rappellent ceux du sport de haut niveau, où la frontière entre optimisation et dopage n’est jamais claire. Ils interrogent notre rapport à la performance : cherchons-nous à célébrer l’humain dans sa pure expression, ou l’humain augmenté par la technologie ?
Dopage et apnée : l’affaire Maričić
Il est important de souligner que Vitomir Maričić, auteur du record d’apnée statique à l’oxygène, a récemment été suspendu pour dopage par la CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), l’une des deux fédérations internationales qui régissent l’apnée.
En juillet dernier, à leur arrivée aux Bahamas pour la compétition Vertical Blue, Maričić et son compatriote Petar Klovar ont été accusés de possession de substances considérées comme dopantes dans le cadre de l’apnée : sildénafil (Viagra) et benzodiazépines.
-
Ces substances ne figurent pas encore sur la liste WADA (Agence Mondiale Antidopage) pour l’ensemble des sports, mais elles sont interdites par la CMAS dans toutes les disciplines subaquatiques qu’elle encadre.
-
La CMAS a jugé que leur présence était de nature à altérer le résultat des compétitions et à mettre en danger la santé des athlètes.
Verdict : amende de 5 000 € et suspension de 6 mois à compter du 27 novembre, empêchant Maričić et Klovar de participer aux compétitions CMAS jusqu’à fin mai.
L’affaire a d’ailleurs créé une fracture entre les deux instances mondiales d’apnée :
-
La CMAS, qui a immédiatement sanctionné les athlètes.
-
L’AIDA, l’autre fédération internationale, qui leur a permis de concourir aux championnats du monde de Chypre quelques semaines plus tard.
Cette divergence illustre bien les enjeux :
-
Comment définir un dopage en apnée, discipline où l’exploration des limites humaines passe parfois par des apports exogènes (oxygène pur, substances pharmacologiques, techniques d’adaptation) ?
-
Quelle gouvernance sportive est la plus à même de préserver à la fois la santé des athlètes et l’équité entre concurrents ?
La CMAS, à travers sa campagne “Fair Play”, se présente aujourd’hui comme la fédération la plus engagée dans la lutte contre le dopage en apnée.
Un souffle pour tous
Au-delà de ces records hors norme, et des ces polémiques de dopage, malheureusement souvent associées à la pratique d’une discipline l’apnée reste une discipline accessible. Bien encadrée, elle procure des bénéfices profonds sur la santé, le mental et l’émotionnel. Elle apprend à calmer l’esprit, à tolérer l’inconfort, à écouter son corps. Pas besoin de viser 29 minutes pour en ressentir les fruits.
C’est là tout l’intérêt d’un exploit médiatisé : inciter chacun à s’essayer, à explorer de façon raisonnée la rétention du souffle. C’est ce que j’explique dans mon article de blog sur les bienfaits de l’apnée et dans les épisodes du podcast In the Air avec Christian Vogler et Morgan Bourc’his, deux voix inspirantes de la discipline.
Un petit pas pour un homme, un grand pas pour… la respiration ?
Maričić a peut-être franchi une étape de plus dans l’exploration des limites humaines. Ces « extra-humains » interrogent nos repères, stimulent la recherche, inspirent nos pratiques. À nous de retenir leur leçon essentielle : respirer n’est pas qu’un automatisme. C’est une compétence.
FAQ – Record du monde d’apnée statique avec oxygène
1. Quelle est la différence entre apnée avec oxygène et apnée sans oxygène ?
-
Avec oxygène : l’apnéiste respire 100 % d’O₂ pendant plusieurs minutes avant l’apnée. Les réserves sont beaucoup plus grandes (oxygène dissous dans le plasma en plus de l’hémoglobine saturée), ce qui permet des records très longs.
-
Sans oxygène : l’apnéiste prend une inspiration d’air ambiant (21 % d’O₂). Les performances sont plus courtes, mais reflètent davantage les limites physiologiques “naturelles”.
2. L’oxygène pur n’est-il pas dangereux ?
Oui, à haute concentration et sur des temps prolongés, l’oxygène peut provoquer une toxicité aiguë : excès de radicaux libres, lésions pulmonaires ou neurologiques. Dans le cadre d’une apnée statique de courte durée et encadrée, le risque reste limité, mais l’usage répété ou hors contrôle peut être nocif.
3. Que se passe-t-il dans le corps pendant une apnée longue ?
-
Le CO₂ s’accumule dans le sang, provoquant contractions involontaires du diaphragme.
-
L’oxygène diminue progressivement, entraînant une hypoxie si elle devient trop basse.
-
Le cœur ralentit fortement (bradycardie d’apnée), ce qui économise l’énergie.
-
Les muscles et le cerveau passent en mode “économie d’oxygène”.
-
Au-delà d’un certain seuil, la baisse de l’oxygène peut entraîner une syncope hypoxique, c’est-à-dire une perte de connaissance brutale, sans signes avant-coureurs. C’est pourquoi il ne faut jamais pratiquer l’apnée seul.
4. Peut-on s’entraîner pour augmenter ses temps d’apnée ?
Oui, par :
-
le travail ventilatoire (souplesse thoracique, diaphragmatique),
-
l’amélioration de la tolérance au CO₂,
-
l’entraînement cardiovasculaire,
-
la pratique régulière de l’apnée (progressive, encadrée).
Mais attention : jamais seul. Le risque de syncope hypoxique est réel.
5. Pourquoi ces records sont-ils importants pour la science ?
Ils montrent jusqu’où le corps humain peut s’adapter. Les recherches sur l’apnée trouvent des applications :
-
en médecine (gestion de l’hypoxie, soins intensifs, hyperbarie),
-
dans l’armée (opérations sous-marines, aviation de haute altitude),
-
dans l’espace (adaptation aux environnements extrêmes).
6. Tout le monde peut-il pratiquer l’apnée ?
Oui, à condition de respecter quelques règles :
-
toujours pratiquer encadré ou avec un binôme,
-
progresser progressivement,
-
écouter ses sensations,
-
intégrer la relaxation et la gestion du stress.
Même quelques secondes d’apnée consciente apportent déjà des bénéfices sur le mental, l’attention et la régulation du système nerveux autonome.